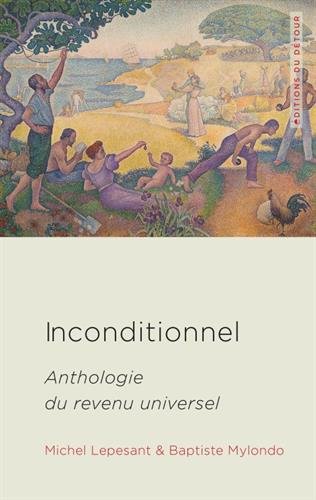 Le revenu universel n’en finit pas de gagner en audience – et de gagner du terrain au fil des expérimentations : serait-il l’outil de transition approprié pour remédier à l’érosion continue de notre « modèle social » voire pour assurer une « organisation plus intelligente des richesses » ? Les philosophes Michel Lepesan et Baptiste Mylondo ont réuni une anthologie de textes fondateurs qui retrace l’évolution d’une idée dont l’heure semble venue…
Le revenu universel n’en finit pas de gagner en audience – et de gagner du terrain au fil des expérimentations : serait-il l’outil de transition approprié pour remédier à l’érosion continue de notre « modèle social » voire pour assurer une « organisation plus intelligente des richesses » ? Les philosophes Michel Lepesan et Baptiste Mylondo ont réuni une anthologie de textes fondateurs qui retrace l’évolution d’une idée dont l’heure semble venue…
Le « revenu universel » est une vieille idée qui balaie large, de droite à gauche de « l’échiquier politique » : à chaque échéance électorale, elle suscite désormais un tsunami éditorial qui n’en obscurcit que davantage l’enjeu dans une nuée épaisse d’encre, de verbiages, de surenchères de marketing électoraliste et d’« éléments de langage » recouvrant des stratégies politiques plus ou moins antagonistes.
De quoi s’agit-il au juste ? Le Mouvement français pour un revenu de base (MFRB, fondé en mars 2013) définit ainsi le principe d’une allocation inconditionnelle garante d’un « droit de vivre » et couvrant les besoins vitaux de chacun comme un « droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. »
Philosophes avant tout, Michel Lepesant et Baptiste Mylondo entendent éclaircir le débat par une anthologie historique qui donne la parole davantage aux… philosophes qu’aux « économistes » dont le présumé « savoir » érigé en religion a creusé la fosse commune d’un endettement collectif insoutenable tout en perpétuant une abyssale ignorance de ce qui fonde la prospérité des nations – à moins qu’il ne s’agisse de « faire l’œuvre de Dieu » en jouant le sort de l’espèce au casino…
Mais… est-il « raisonnable » de « donner de l’argent aux gens » jusque pour qu’ils aient le « droit de vivre » ?
Le droit de vivre…
L’ idée d’un « droit à la vie » a été formulée pour la première fois par l’humaniste chrétien Thomas Moore (1478-1535), le parfait contemporain de la révolution agraire des enclosures qui a « désagrégé la société rurale traditionnelle anglaise » : il imaginait dans L’Utopie (1516) une île où chacun serait assuré de sa subsistance sans dépendre de son travail.
Cette garantie ne va pas sans une contribution au bien-être collectif, assurée par six heures quotidiennes vouées à l’agriculture. Tout comme Tommaso Campanella (1568-1639), il décrivait ce que pourrait être une cité idéale – les deux concepteurs de l’anthologie rappellent les deux interprétations possibles du terme « utopie » : ce qui n’a pas eu lieu (u-topia) ou « ce qui est le lieu du bonheur » (eu-topia)…
Le révolutionnaire Thomas Paine (1737-1809) plaidait dans La Justice agraire (1796) pour une dotation inconditionnelle issue des ressources naturelles et de la terre : « Tout propriétaire de terre cultivée doit à la communauté une rente agricole du fait de la terre qu’il possède. »
Charles Fourrier (1772-1837) dans sa Lettre au Grand Juge, a l’intuition d’un « minimum décent », versé aux plus pauvres « sous la seule forme de prestations en nature » : « Dès que le peuple jouira constamment de l’aisance et d’un minimum décent, toutes les sources de la discorde seront taries ou réduites à très peu de choses. »
Dans Le Monde qui pourrait être (1918), le philosophe et mathématicien Bertrand Russell (1872-1970), « socialiste » anglais, estime qu’il « faut assurer à chacun, qu’il travaille ou non, un modeste revenu, suffisant pour le strict nécessaire » ainsi qu’un « revenu plus grand, dont l’importance dépendrait de la somme des biens produits », attribué à ceux qui « veulent bien s’employer à un travail que la collectivité juge utile ».
Michel Lepesan et Baptiste Mylondo rendent justice au perpétuel grand oublié de toutes les contributions prétendant retracer l’histoire du revenu universel : l’ancien député radical-socialiste français Jacques Duboin (1878-1976) dont l’abondante œuvre journalistique et livresque rappelait l’évidence que « lorsqu’il y en a assez alors il est absolument injuste que ça ne soit pas pour tout le monde ».
L’éphémère sous-Secrétaire d’Etat au Trésor d’Aristide Briand (1862-1932) prônait une simplification de l’économie dans la logique des circuits courts afin d’organiser directement une « adéquation entre production et consommation ». Cela suppose « l’abolition du capital et du salariat » ainsi que la « réduction de l’argent à sa seule fonction comptable » par une « monnaie distributive ne circulant pas mais fondant dès sa première utilisation pour empêcher tout placement spéculatif ». Entre les deux guerres (et après…) il a préconisé un « revenu social » rendu possible par la « grande relève » de la productivité machiniste : « L’homme possède le droit à la vie, car il le tient des lois de la nature. Il a donc droit à sa part dans les richesses du monde. Grâce à son travail, il pouvait se procurer cette part et ainsi gagner sa vie. Il le pourra désormais de moins en moins, car son travail est progressivement éliminé par un gigantesque appareil de production qui rend tous les jours le labeur humain moins nécessaire. Cependant les progrès techniques qui se succèdent, en libérant de plus en plus l’homme de ses occupations matérielles ne doivent pas le priver des biens créés sous prétexte que son travail n’a pas été nécessaire. En effet, si l’homme est dénué des moyens d’existence, son droit à la vie devient un leurre. »
Aussi, si « les droits politiques ne suffisent plus pour assurer la liberté des hommes », pourquoi ne pas leur donner de quoi vivre en complétant les droits de l’homme par des droits économiques « concrétisés par un revenu social du berceau au tombeau » ? Ce revenu social « dissocie ainsi le travail et sa rémunération puisque le travail de l’homme, conjugué avec celui de la machine, fournit un rendement qui n’est plus proportionnel ni à la peine ni à l’effort du travailleur. En distribuant aux consommateurs, sous forme de revenu social, la contre-valeur des biens mis en vente, la population aurait ainsi les moyens d’acquérir tout ce qui a été produit » (Les Yeux ouverts, 1955).
Un nouveau pilier du système de protection sociale ?
Pour ces défenseurs actuels, ce principe d’un « droit à vivre » pourrait répondre tout à la fois à l’essoufflement de notre système de protection sociale fondée sur une norme de « plein-emploi » révolue alors que le loup numérique est entré dans la bergerie de la société du « travail », à la précarisation de la condition salariale et à l’incohérence d’un empilement pour le moins illisible de dispositifs inquisiteurs d’aides conditionnelles qui dissuade nombre de « bénéficiaires » potentiellement éligibles de les demander …
La protection sociale s’est construite autour du salariat et les droits sont attachés au statut de salarié. Mais ce système s’essouffle avec l’exacerbation d’un chômage de masse structurel dans une société exponentielle où le travail se fait intermittent, indépendant, aléatoire voire gratuit…
Cette « utopie réaliste » constituerait l’amortisseur social capable d’absorber le « choc historique » frappant un nombre croissant de perdants de l’automatisation, lors du passage de la société industrielle à une économie numérique « ubérisée » dont les seules innovations avérées (fiscales et financières pour se soustraite aux dépenses sociales et à l’impôt) épuisent les ressources communes … Des millions de vies, rendues « inutiles » par « l’ubérisation », pourraient-elles retrouver ainsi une marge de survie voire d’autonomie grâce à ce filet de sécurité leur permettant d’apporter une contribution positive à la société par une activité librement choisie ?
Car enfin, plutôt que de demander à une personne de travailler pour un salaire, ne vaudrait-il pas mieux lui accorder un revenu universel afin qu’elle puisse… travailler et devenir créatrice de richesse sociale en-dehors d’un emploi salarié en vue de raréfaction ? La « création d’emplois » peut-elle être considérée encore comme une fin en soi, à en juger le nombre d’emplois inutiles voire nuisibles qui plombent la santé économique de nos sociétés voire la santé publique ?
Les partisans du revenu universel le tiennent pour un nouveau pilier de notre système de protection sociale qui procure à chacun une autonomie accrue pour « s’émanciper et se réaliser en tant que travailleur, citoyen et individu ». Versé à tous, il n’est plus lié à une situation d’exclusion mais traduit une reconnaissance comme « membre de la communauté ». Ce droit émancipateur permettrait d’en finir avec la stigmatisation des « sans-emploi », à la rhétorique de « l’assistanat » comme à la tragédie du non-recours au droit à certains minima sociaux.
Les textes rassemblés par Michel Lepesan et Baptiste Mylondo laissent entrevoir une avancée dans une condition humaine qui s’est jusqu’alors affranchie de l’esclavage puis de la féodalité avant de se retrouver sous le joug de la religion du « travail » de moins en moins salarié – avant que ne se tourne la page du salariat…
Jusqu’alors, le « paradigme dominant » empêchait de penser le monde qui vient comme il empêche de le créer. Cette anthologie permet précisément de (re)penser le revenu universel comme un outil de transition conjuguant efficacité et équité, voire même comme le « prochain modèle économique de l’humanité » qui nous ferait passer d’une société de précarité subie à une société de mobilité vraiment choisie.
La double mesure d’un revenu minimum et d’un revenu maximum
Dans un monde-là, l’instauration d’un tel revenu supposerait aussi d’en finir avec « l’optimisation fiscale » permettant de se soustraire aux obligations de solidarité minimales et ne pourrait être envisagée qu’avec un plafonnement des hauts revenus (un « revenu maximum autorisé ») ainsi que le rappelle Alain Caillé : « (…) le combat prioritaire à mener aujourd’hui (…) passe par le couplage de la lutte contre la logique de la démesure – les puissances de l’illimitation libérées par l’explosion du capitalisme spéculatif – avec la lutte contre l’explosion des inégalités (…) La quasi-totalité des problèmes qui se posent (…) renvoie systématiquement à la question des limites qu’il nous faut définir et imposer aux forces de la démesure, de l’hubris, si nous voulons que notre monde reste humain et habitable. »
Sortir une population de la pauvreté suppose une fiscalité plus « raisonnable » des revenus élevés, une « solidarité » effective élargie à ceux qui jusqu’alors se « distinguent » par une propension flagrante à s’en exonérer (« que chacun contribue selon ses moyens »…) ainsi qu’une articulation de la question sociale des inégalités à l’enjeu écologique de la soutenabilité…
Il s’agit bien de décider dans quelle société nous voulons vivre afin de pouvoir impulser le mouvement plutôt que de le subir. Les incertitudes quant au financement du revenu universel pourraient être résolues par sa mise en œuvre progressive avec les ajustements qui s’imposent – autant partir du principe pour dégager graduellement des marges de financement… Ainsi peut-être retrouverions-nous la pleine conscience de ce qui nous fonde comme civilisation encore soutenable et habitable. En grande maison commune où chacun serait libre de passer de l’état de fourmi à l’état de cigale et inversement ?
Michel Lepesan et Baptiste Mylondo, Inconditionnel – Anthologie du revenu universel, éditions du Détour, 256 p.
Trouvé sur https://www.agoravox.fr/


























